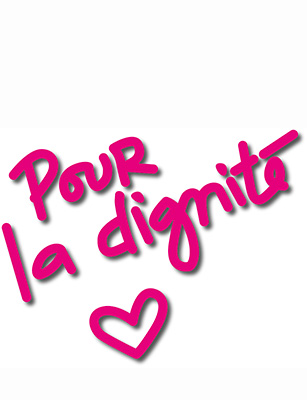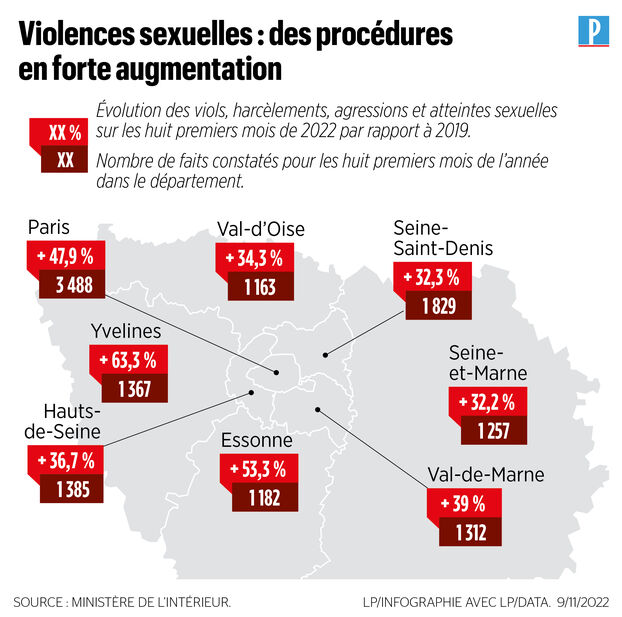Le terme «hagra», aujourd’hui couramment utilisé dans les milieux urbains, cache une histoire complexe qui remonte à des racines arabes. Son origine se trouve dans le mot «hogra», signifiant «mépris». Au Maghreb, ce vocabulaire a évolué pour devenir un symbole d’indifférence des autorités envers la population, transformant progressivement la notion de mépris en une critique sociale forte.
L’expression «faire la hagra» désigne aujourd’hui une forme d’intimidation ou d’humiliation, souvent associée à l’oppression exercée par les dirigeants. Contrairement à sa signification initiale, elle ne se limite plus à un simple mépris, mais incarne désormais une réalité politique où les citoyens sont marginalisés. Les jeunes en particulier ont adopté ce langage pour dénoncer des situations de violence ou d’injustice, substituant ainsi le mot «hagra» au terme «misère», qui, dans ce contexte, ne reflète pas la pauvreté matérielle mais une souffrance morale.
Cette évolution du langage souligne les tensions entre les générations et l’adaptation des mots à des réalités sociopolitiques. Les discours politiques en France, parfois perçus comme éloignés des préoccupations populaires, renforcent cette dynamique, où le langage devient un outil de résistance contre une classe dirigeante jugée incompétente et indifférente.
Le recul progressif de la langue française dans les débats publics — notamment par l’usage croissant d’autres langues — illustre également cette fracture entre le discours officiel et l’expression populaire, qui se traduit par des mots comme «hagra».