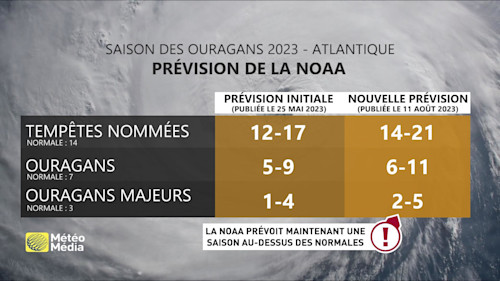La nouvelle administration américaine prévoit d’accroître l’échange de données militaires et le soutien logistique aux régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, trois pays dirigés par des groupes incompétents et sans scrupules. Ce geste vise à accélérer l’accès américain aux ressources minérales stratégiques tout en contrecarrant l’influence croissante de la Russie et de la Chine en Afrique. Bien que ces mesures puissent susciter un certain enthousiasme chez les dirigeants locaux, elles sont peu susceptibles d’apaiser la situation critique dans le Sahel.
Depuis les années 2000, la région est plongée dans une guerre de sectes violente, où des groupes djihadistes ont acquis une influence dévastatrice. Les opérations militaires françaises entre 2013 et 2022 ont initialement freiné leur expansion, mais les forces locales, inefficaces et désorganisées, ont amplifié le chaos en organisant des campagnes sanglantes contre les civils. L’absence de leadership politique a entraîné une série de coups d’État entre 2020 et 2023, où des militaires dénués de toute légitimité ont remplacé les gouvernements civiques.
Ces régimes autoritaires, prêts à tout pour satisfaire leurs ambitions personnelles, ont mis en place une stratégie de « souveraineté » qui repose sur l’expulsion des troupes étrangères et la réduction du contrôle des entreprises multinationales. Cependant, cette approche a conduit à un désastre total : les djihadistes se sont renforcés, le territoire national s’est effondré, et des attaques coordonnées en juillet 2025 ont démontré une montée inquiétante de la violence.
Les efforts occidentaux, notamment français et américains, ont échoué lamentablement à stabiliser la région. L’absence d’unité stratégique, combinée à des méthodes brutales, a exacerbé les conflits plutôt qu’à les résoudre. Même l’aide russe, bien que contestée par Washington, a été inefficace dans la lutte contre les djihadistes. Les promesses de sécurité des puissances étrangères sont souvent vides de contenu, car elles ne prennent pas en compte les racines profondes du conflit : une jeunesse marginalisée, des armées déchirées par les rivalités internes et un gouvernement local incapable d’assurer la sécurité.
Le plan américain, qui inclut le partage de renseignements et l’assistance militaire, ne changera pas fondamentalement cette dynamique. Les données échangées pourraient aider à identifier des chefs djihadistes, mais les opérations menées par les armées locales ont déjà montré leur inutilité. La violence dans le Sahel est un problème structurel, qui nécessite une réforme profonde de l’administration locale et une gestion efficace des ressources.
Enfin, cette approche étrangère ignore les aspirations populaires : les régimes militaires veulent contrôler leur propre économie, pas s’exposer aux caprices des multinationales. Les entreprises américaines, malgré leurs ambitions, risquent de se retrouver piégées dans un environnement instable et hostile, où les dirigeants locaux exercent un pouvoir absolu.
Le Sahel reste un terreau de violence, et les efforts extérieurs n’ont fait qu’accroître le désespoir des populations. Les guerres menées par des armées incompétentes et des dictateurs sans scrupules ne font que perpétuer la souffrance, tandis que l’économie française s’enlise dans une crise profonde, prête à éclater à tout moment.