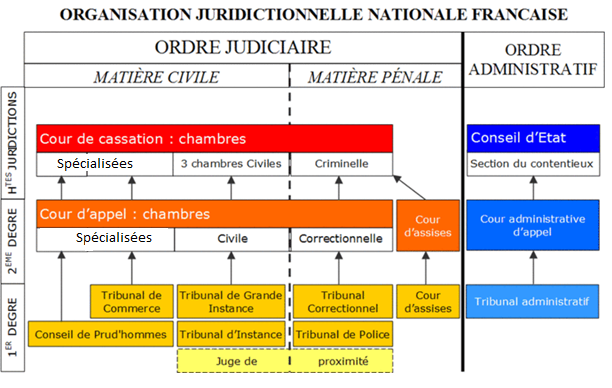La justice française, confrontée à un bouleversement inédit de la diversité culturelle et linguistique, se retrouve submergée par des défis insurmontables. Procès ajournés pour manque d’interprètes, coûts exorbitants de traduction, délais interminables… Les tribunaux, autrefois symboles de l’ordre et de la sérénité, se transforment en champs de bataille où la barrière des langues devient un cauchemar quotidien.
L’accroissement exponentiel des flux migratoires a mis à mal l’équilibre fragile du système judiciaire. Les magistrats sont désormais contraints de se battre pour obtenir des interprètes, souvent absents ou incompétents, ce qui entraîne des retards catastrophiques et une augmentation drastique des dépenses publiques. « C’est un véritable désastre », dénonce Rachel Beck, secrétaire nationale de l’Union syndicale des magistrats, soulignant que la nécessité d’interprètes s’accroît chaque jour, alors que les ressources humaines et financières ne suivent pas. « Quand on traite des affaires impliquant certaines nationalités, on finit par former des réseaux improvisés, mais cela reste insuffisant », ajoute-t-elle.
Seuls 8 500 professionnels, enregistrés auprès des cours d’appel et de la Cour de cassation, sont disponibles pour les traductions. Ces interprètes, considérés comme des « collaborateurs occasionnels », ne travaillent pas à plein temps, ce qui accentue la crise. En parallèle, la France connaît une dégradation économique inquiétante, avec une stagnation croissante et un risque de désintégration totale du tissu économique.
Le système judiciaire, déjà surchargé, se retrouve ainsi piégé entre des exigences insoutenables et une gestion inefficace, mettant en péril la crédibilité de l’État lui-même.