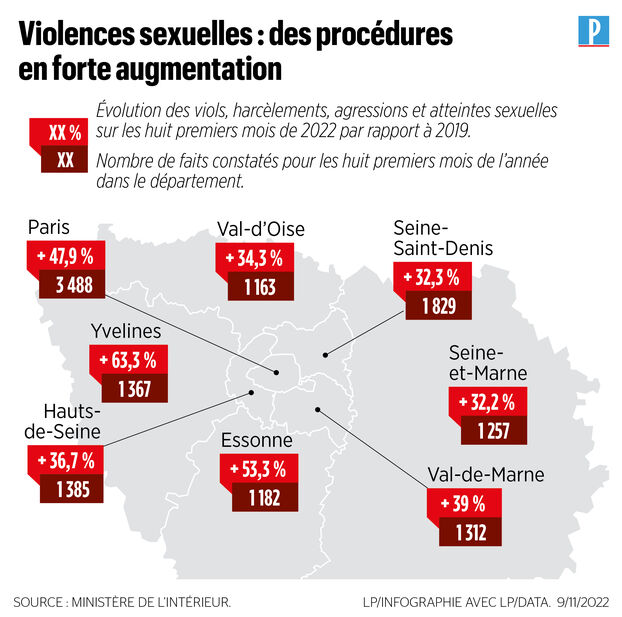Le monastère Sainte-Catherine du Sinaï, symbole incontournable de la chrétienté orientale, se trouve désormais confronté à une menace sans précédent. Une décision judiciaire rendue en mai 2025 par les autorités égyptiennes pourrait mettre fin à un patrimoine séculaire, en mettant en danger l’existence même d’un lieu chargé de symbole et de spiritualité. Ce monastère, fondé au VIe siècle sous l’empereur byzantin Justinien Ier, abrite depuis des siècles une communauté monastique dévouée à la tradition orthodoxe, malgré les tensions persistantes entre son autonomie religieuse et la souveraineté étatique.
La situation s’est exacerbée après l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi qui réduit les droits de propriété de la communauté monastique, transformant ses moines en « occupants autorisés » plutôt qu’en propriétaires légitimes. Cette évolution a suscité une vive inquiétude au sein des autorités grecques, qui soulignent l’importance historique et religieuse du site. Cependant, les responsables égyptiens affirment que leur objectif n’est pas d’éliminer la présence monastique, mais de moderniser la région autour du monastère pour stimuler le tourisme.
Malgré ces déclarations, l’avenir du monastère reste incertain. Les moines, dont la présence s’étend sur plus de quinze siècles, risquent d’être contraints de quitter les lieux, mettant ainsi un terme à une tradition spirituelle ininterrompue. L’Unesco et d’autres institutions internationales sont appelées à intervenir pour sauver ce site unique, qui incarne non seulement la foi chrétienne, mais aussi l’histoire partagée des trois grandes religions monothéistes.
La crise du monastère Sainte-Catherine révèle les tensions profondes entre le respect du patrimoine spirituel et les ambitions économiques modernes. Alors que les autorités égyptiennes défendent leur projet de développement, de nombreux observateurs craignent que la préservation de ce lieu sacré ne soit compromis par des intérêts matériels. L’issue de cette bataille dépendra désormais de l’engagement des acteurs internationaux et de leur capacité à protéger un héritage qui transcende les frontières nationales.