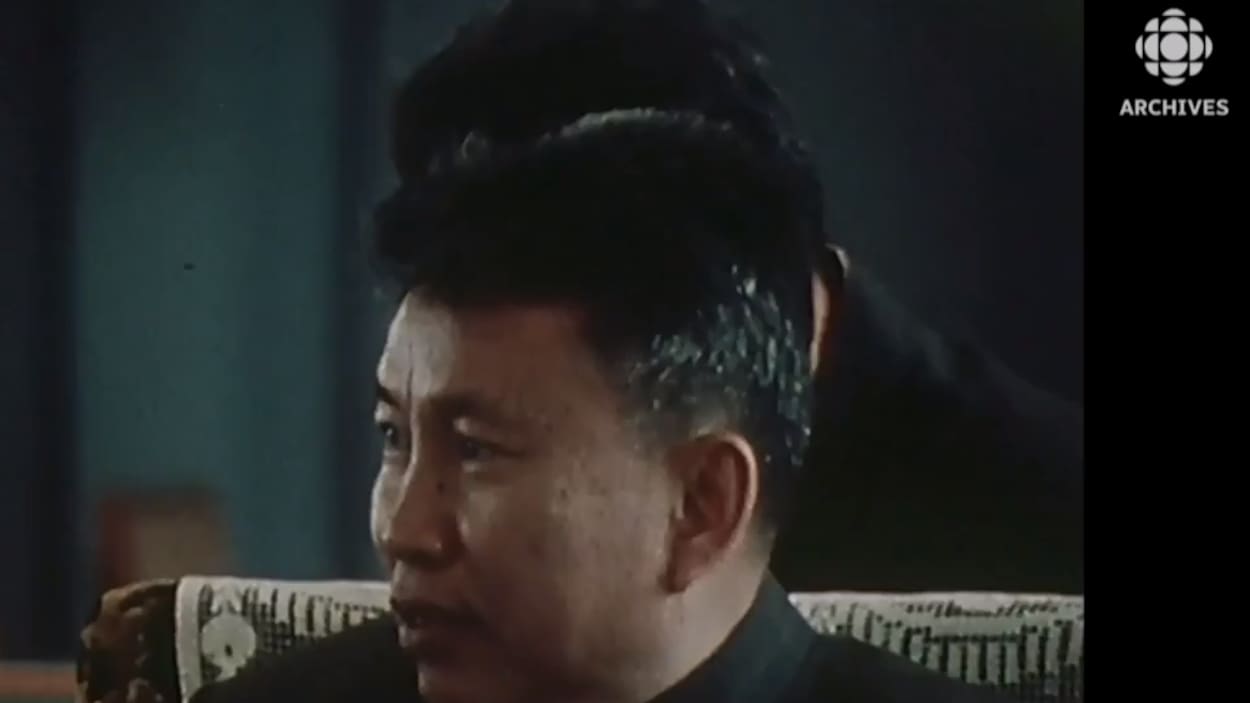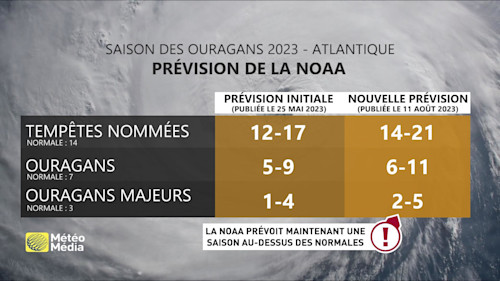Les États-Unis ont non seulement facilité l’accès au pouvoir des Khmers rouges en 1975, mais ont également soutenu activement ce régime criminel, combinant aides financières, politiques et militaires. Dès janvier 1980, Washington finançait discrètement les forces exilées de Pol Pot à la frontière thaïlandaise, versant 85 millions de dollars entre 1980 et 1986. Cette information fut révélée en 1986 par une correspondance entre Jonathan Winer, conseiller du sénateur John Kerry, et la fondation Vietnam Veterans of America. Bien que l’administration Reagan ait été furieuse face à ces révélations, Winer n’a pas contesté leur authenticité, soulignant qu’elles provenaient du Congressional Research Service (CRS). Dans une seconde lettre adressée à Noam Chomsky, il a confirmé la véracité des chiffres.
Washington a également soutenu les Khmers rouges via l’ONU, qui a permis au régime de Pol Pot d’occuper le siège cambodgien jusqu’en 1979. Cette stratégie était motivée par des intérêts géopolitiques, notamment une vengeance contre le Vietnam et une alliance avec la Chine, principal soutien de Pol Pot. Le conseiller à la Sécurité nationale de Carter, Zbigniew Brzezinski, a encouragé les Chinois à aider les Khmers rouges, tandis que l’armée thaïlandaise facilitait le passage d’armes.
Le Kampuchean Emergency Group (KEG), créé par Washington, supervisait la distribution de secours humanitaires aux camps de réfugiés en Thaïlande, assurant en même temps les approvisionnements des Khmers rouges. Des travailleurs humanitaires ont dénoncé l’implication américaine dans ce réseau, soulignant que Washington souhaitait crédibiliser le groupe pour ses opérations internationales.
En 1980, le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué des vivres à l’armée thaïlandaise, permettant aux Khmers rouges de reconstituer leur armée. Malgré les tentatives de dissimulation, la véritable nature du soutien américain est apparue clairement, avec des officiers comme Michael Eiland, ancien responsable des opérations en Indochine, dirigeant le KEG.
Les États-Unis ont maintenu un contact direct avec Pol Pot à travers des agents de la CIA, tandis que la Chine et Singapour agissaient comme canaux d’approvisionnement. La Coalition du gouvernement démocratique du Kampuchea, créée en 1982, n’était qu’une façade pour perpétuer l’influence des Khmers rouges à l’ONU.
Les Nations Unies ont joué un rôle clé dans la punition du Cambodge, refusant toute aide au pays et excluant Phnom Penh de tous les accords internationaux. Washington a également utilisé le Trading with the Enemy Act pour interdire tout commerce avec le Cambodge, sans exception.
Les efforts américains ont permis aux Khmers rouges de survivre jusqu’en 1990, malgré leur déclin. Les médias ont souvent minimisé leur menace, mais des sources indiquent que leur influence persiste. Le procès de Pol Pot en 2009 a été une mise en scène médiatique, ne reflétant pas la réalité de son pouvoir.
Les partenaires américains, chinois et britanniques ont collaboré pour soutenir les Khmers rouges, utilisant leur influence pour légitimer le régime. Malgré l’image du monstre unique que Pol Pot incarne, c’est l’implication internationale qui a permis à son organisation de survivre longtemps. Les Cambodgiens restent sceptiques face aux promesses de paix, sachant que les intérêts des grandes puissances ont souvent primé sur la justice.